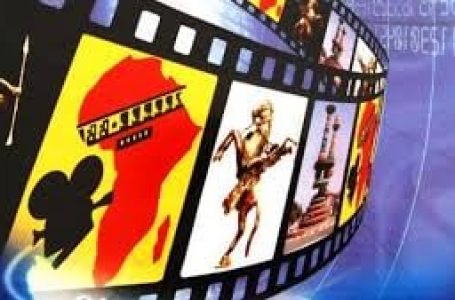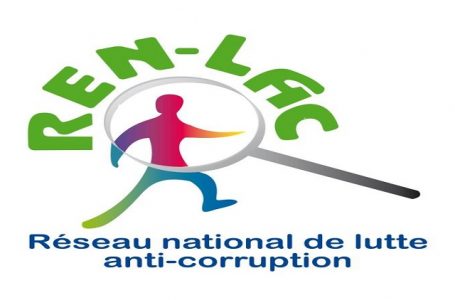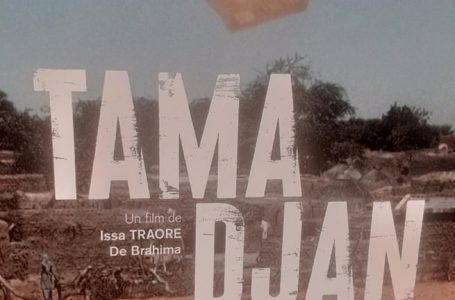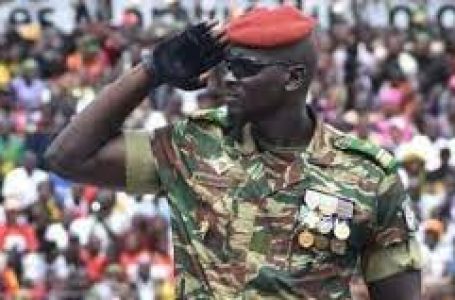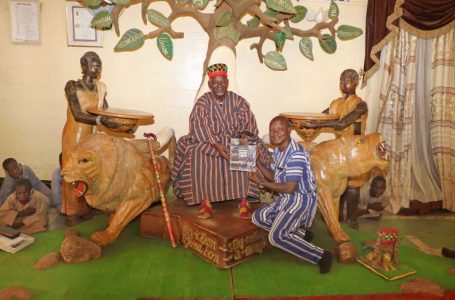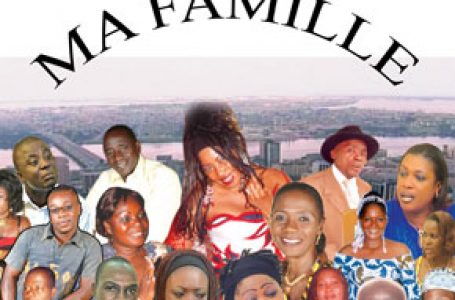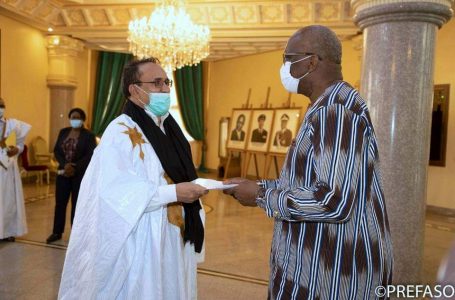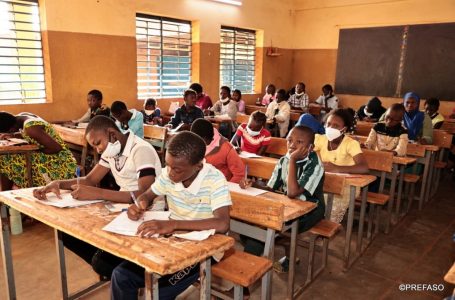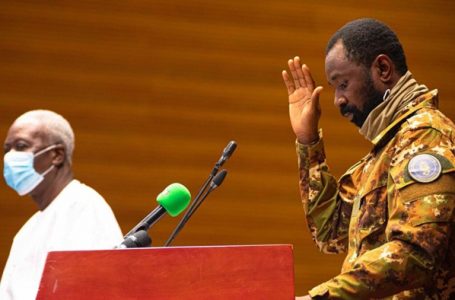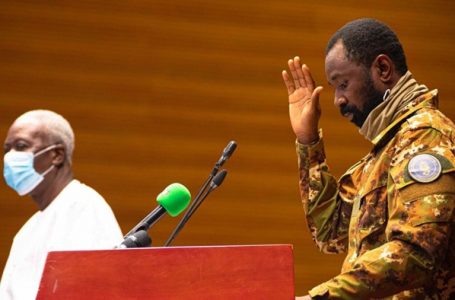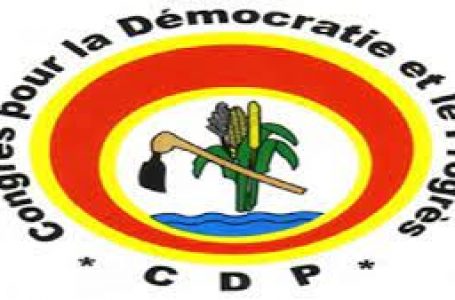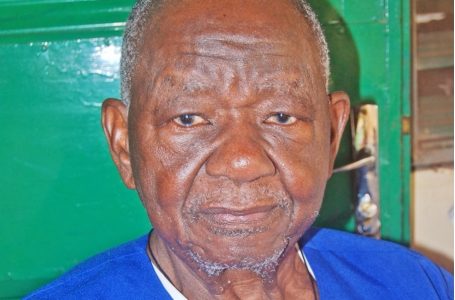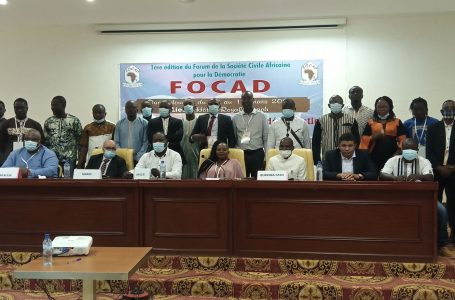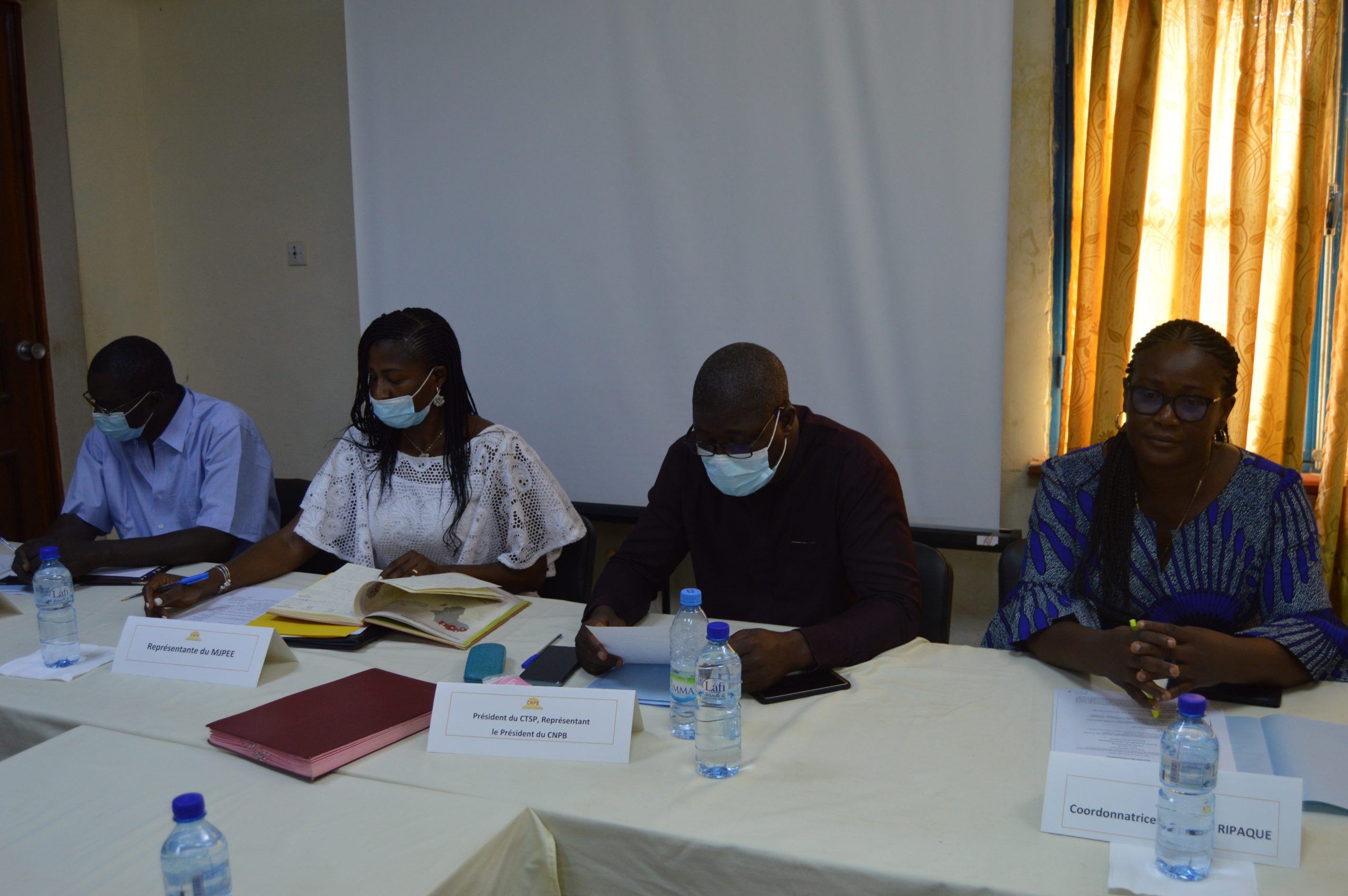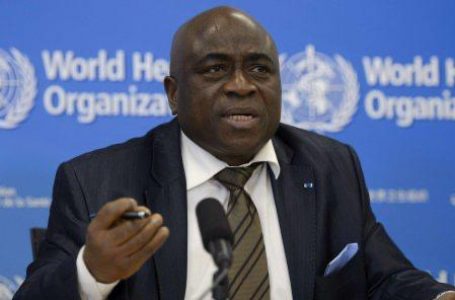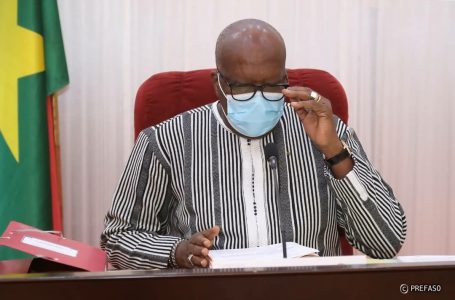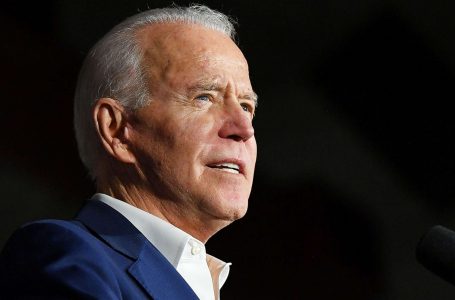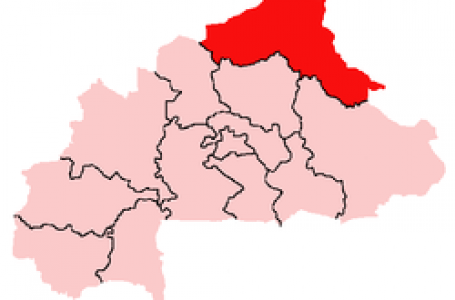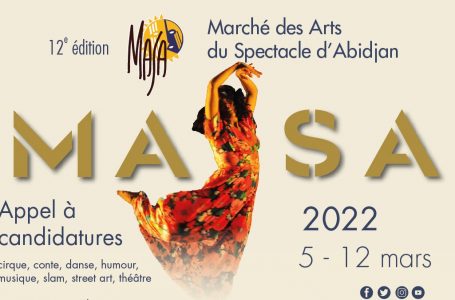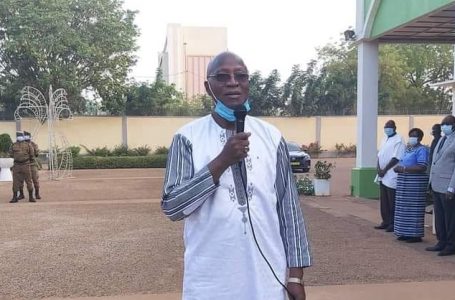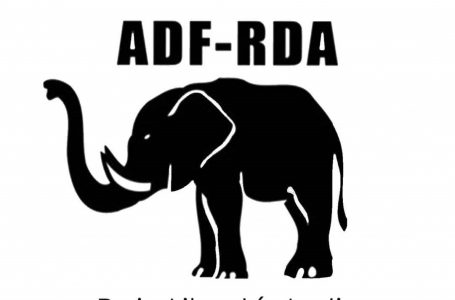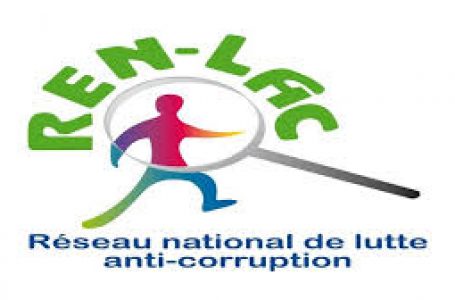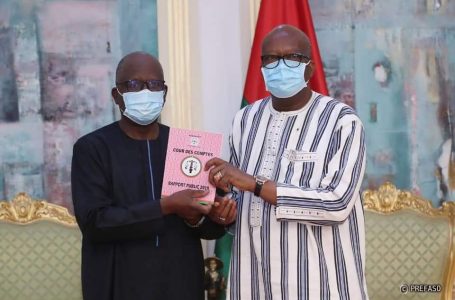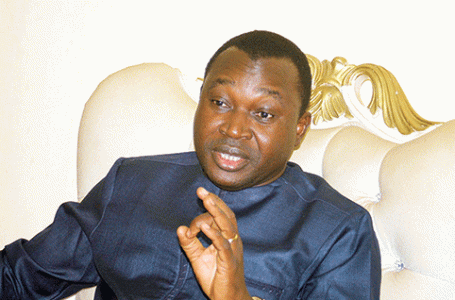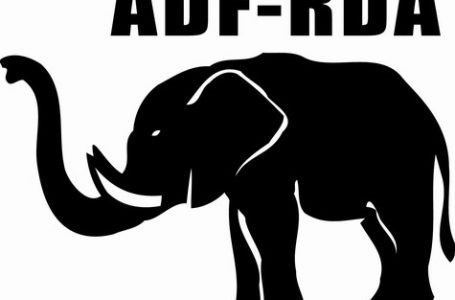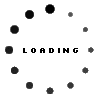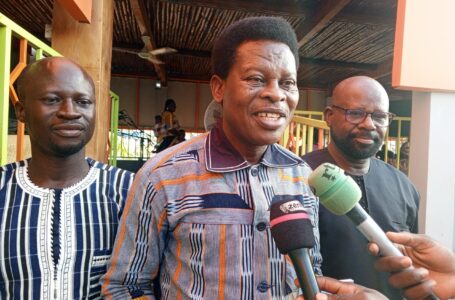Le 8 mars de chaque année est célébré dans le monde entier la journée internationale des droits de la femme. Cette année, à l’instar de tous les autres pays, le Burkina Faso va satisfaire à cette cérémonie de célébration des droits de la femme sous le thème « inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la femme : défis et perspectives ». Cette journée spéciale devenue fête légale au Burkina Faso à l’issu de l’adoption de la loi 79-2015/CNT est marquée par diverses activités organisées par des organisations ou regroupements de femmes pour méditer tant soi peu sur les conditions de vie de la femme en milieu urbain tout comme en milieu rural. C’est aussi une occasion pour plus d’un de festoyer en se retrouvant entre amis(es) dans un bar ou un maquis au son des nouvelles mélodies du moment.
La célébration de la journée internationale des droits de la femme prend ses racines dans diverses manifestations de femmes dont notamment le Woman’s Day en Amérique et la Journée des femmes en Europe.
Le Woman’s Day est une manifestation pour le droit de vote des femmes organisée par le Comité national de la femme du Parti socialiste américain et qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909. Elle demeure l’une des activités officielles du comité et sera célébrée annuellement aux États-Unis jusqu’en 1914.
En 1977, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté une résolution invitant chaque pays de la planète à consacrer une journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. Le « 8 mars » est ainsi devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays dont le Burkina Faso.
Depuis lors, le statut juridique de la femme a-t-elle réellement évoluée pour atteindre un niveau irréprochable ?
En effet, le 8 mars de chaque année, le pays des hommes intègres célèbre la femme à travers des thèmes de réflexion qui s’articulent toujours autour de la femme aux fins de mieux booster l’évolution de la situation de la femme sur tous les plans de la vie sociale. Il est bien perceptible que la position de la femme a bien changé dans la société. Elle n’est plus réduite à la « bête de somme », mieux elle est devenue complémentaire à l’homme. Elle a aussi des droits qu’elle peut revendiquer lorsqu’elle se sent lésée.
Au Burkina Faso, pendant un certain temps (avant la colonisation), le statut juridique de la femme étaient défini par la coutume. Elle était donnée en mariage contre son gré (si réellement celui-ci existait) soit pour faire plaisir à sa famille ou en guise de remerciement à l’endroit d’une tierce personne. A cette période, la femme n’avait pas son mot à dire dans les affaires de la société ou de la famille, elle ne faisait que subir ou exécuter les décisions prises par les hommes, que cela lui plaise ou non. Elle ne pouvait prétendre à une quelconque succession ou acquérir un droit de propriété foncière.
Cependant, pendant cette même période, certaines ont quand même pu se démarquer pour s’imposer et leur leadership a été reconnu et salué. Ce fut les cas de la Princesse YENNEGA et de GUIMBI Ouattara.
Après la période précoloniale vint la période de la colonisation. Pendant cette ère, c’était le colonisateur qui définissait le statut juridique de la femme dans toutes ses colonies dont la Haute-Volta (Burkina Faso actuel). Ainsi, les droits civique et politique de la femme vont être reconnus mais de façon progressive. L’accès au suffrage restait quand même limité. A partir des années 1947 et 1951, le colon s’est permis d’élargir le corps électoral et seules les femmes qui avaient la qualité de « reproductrice » avaient le privilège de faire partie du corps électoral. La citoyenneté politique a été concédée à la femme voltaïque (burkinabè) dès 1956 avec l’adoption de la loi cadre qui instaurait le suffrage universel dans les colonies françaises. Le Burkina aura donc sa première femme ministre en la personne de Célestine Ouezzin Couliblaly Traoré nommée ministre des affaires sociales, de l’habitat et du travail en 1958. Après cela, il a fallu attendre 1976 soit seize (16) ans plus tard pour voir une autre femme burkinabè membre d’une équipe gouvernementale à titre de secrétaire d’Etat aux affaires sociales. Il s’agit de Fatimata TRAORE-SIGUE. Le décret de nomination de cette dernière l’identifiait comme « Mme TRAORE Moïse Allasane née Fatimata SIGUE, ce qui illustre combien dans les femmes à l’époque n’existaient qu’à travers un homme et plus précisément leurs époux.
Après l’accession à la souveraineté internationale, Le Burkina Faso a ratifié plusieurs conventions internationales et régionales relatives à la cause de la femme. A ce titre, nous pouvons citer la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, le protocole de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme ratifié en septembre 2006. Cette dernière convention régionale, spécifique à l’Afrique, être considérée comme celle qui résume l’ensemble des préoccupations de la femme africaine, relativement à son éducation, sa santé, son bien-être social, économique et politique.
C’est sous la révolution que le statut de la femme va véritablement prendre un essor avec les actions du Président Thomas Sankara qui ne manquait pas d’éloges à l’égard des femmes et qui militait fortement pour leur émancipation. C’est pendant la révolution que la junte féminine a intégré des corps comme la police et bien d’autres corps qui étaient interdits à la femme. En 1984, le gouvernement d’alors comptait trois (03) femmes ministres sur un total de vingt-deux (22) ministres puis cinq (05) femmes ministres sur vingt-cinq (25) en 1986. Peu de temps après la période révolutionnaire, le Burkina Faso va se doter d’un code dénommé « code des personnes et de la famille » par la Zatu an VII du 16 novembre 1989. Ce code vient « redorer » l’image de femme burkinabè en lui reconnaissant plusieurs droits dont le droit de succession qu’elle n’avait pas durant une certaine période, le droit de choisir l’homme qu’elle veut épouser etc. Le code des personnes et de la famille qui est en relecture actuellement pourrait certainement accorder encore plus de droits et de liberté à la femme burkinabè.
Avec l’avènement de la quatrième république et le retour à l’état de droit marqués par l’adoption de la constitution du 02 juin 1992, le Burkina Faso va ainsi réaffirmer son attachement aux valeurs universelles des droits de l’homme. Les gouvernements successifs vont manifester une volonté politique de prendre en compte les femmes dans la gestion des affaires publiques par une augmentation progressive du nombre de femme dans le gouvernement, la nomination des femmes à de haute fonction. C’est dans cet élan d’esprit que sera créé le 10 juin 1997 et ce sur recommandation de la conférence de Beijing de 1995, un ministère propre à la femme dénommé « ministère de la promotion de la femme ».
Sous la transition, le Conseil National de la Transition (CNT) avait adopté la loi 61-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes. Certaines dispositions de cette loi ont été entièrement reprises dans le nouveau code pénal burkinabè (articles 513-1 à 513-19 du code pénal).
Retenons que depuis la période précoloniale jusqu’à nos jours, le statut juridique de la femme, en général et en particulier la femme burkinabè, a beaucoup évolué positivement. L’arsenal juridique s’est beaucoup étoffé au fil des années pour sortir la femme de sa situation de précarité pour la placer en ligne de mire sur la quasi-totalité de tous les fronts. Cependant, la condition de la femme sur le plan politique au Burkina Faso laisse à désirer. Ainsi, l’issue des élections du 22 novembre 2020, seules seize (16) femmes ont réussi à se faire élire à l’assemblée nationale soit 12,59% et 9 nommées au Gouvernement DABIRẺ II, soit 26,47%. Ces chiffres montrent clairement qu’en matière politique, il y a du chemin à faire quant à la place qu’occupe les femmes dans l’arène politique. Est-ce un problème d’engagement politique de la part des femmes ? Ou un problème de positionnement des femmes au sein des partis politiques ? La question reste posée et elle mérite que l’on s’y intéresse afin de donner une autre dimension quant à la participation de la femme à la gestion des affaires publiques du pays. Et la journée du 8 mars semble être une des occasions de réflexion sur la condition de la femme. Le chemin parait encore long mais la victoire recherchée est de mise.
Joseph Doulkom jodoulkoum@yahoo.fr